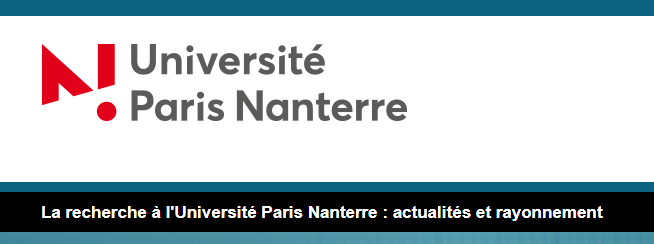Publié le 9 janvier 2025 – Mis à jour le 18 septembre 2025
Liliane Picciola. 7/ XII, 2024
A. PLAN D’ÉTUDE
UNE DRAMATURGIE COMIQUE DE LA PRÉCIOSITÉ :
LA SUITE DU MENTEUR
I . De La Place royale au Menteur : nature des contributions de la
préciosité au genre comique
1. Alidor, l’anti-précieux. L’étonnement et l’extravagance comme
composantes d’une comédie (doc. 1 et doc 2)
2. Philis, le comique d’une précieuse joueuse : entre connivence et
comique relatif
3. Dorante et Clarice : des débatteurs précieux ? La conjouissance
amusée (doc. 3)
II. La préciosité de La Suite du Menteur : les délices de la
stupéfaction
1. L’insertion de la pensée précieuse dans La Suite (docs 4a, 4b, 4c, 4d sur
le néoplatonisme)
2. Le rire d’émerveillement devant les symétries précieuses (doc 4c)
3. La présence associée d’un comique de caractère
III. La variété des rires provoqués par les serviteurs dans La Suite
du Menteur
1. La grâce de la complicité et de la distanciation (doc. 5 ; doc 6)
2. Comiques de gestes et de situation : de l’étonnement à la parodie
3. Le faux comique de caractère de Cliton : terre-à-terre contre
idéalisme ? (doc 4c)B. SOURCES
D’URFÉ, Honoré, L’Astrée, éd. Delphine Denis et alii, Partie I, Partie II, Partie III,
Paris, Honoré Champion, respectivement 2011, 2016, 2022.
D’URFÉ, Honoré, L’Astrée, Première partie, édition critique établie sous la
direction de Delphine Denis, Paris, Honoré Champion, « Champion Classiques
Littératures », n°18, 2011.
Deux visages de l’Astrée, éd. Eglal Henein, https://astree.tufts.edu/
BAUDELAIRE, De l’essence du rire et généralement du comique dans les arts
plastiques, dans Œuvres complètes, éd. M. A. Ruff, Paris, Éditions du Seuil,
L’Intégrale, 1968, p. 370-378.
DUFOUR-MAÎTRE, Myriam, « L’invention de la préciosité », BNF, Les Essentiels,
2023, https://essentiels.bnf.fr/fr/article/47904be5-24e3-4748-ae7f-f073fd4bc50c-
invention-la-preciosite
EDWARDS, Michaël, “Le rire shakespearienˮ, Revue de la BNF, 2011/2 (n° 38),
p. 44-50. DOI : 10.3917/rbnf.038.0044. URL : https://www.cairn.info/revue-de-
la-bibliotheque-nationale-de-france-2011-2-page-44.htm
FICIN, Marsile, Commentaire sur le Banquet de Platon, De l'amour /
Commentarium in convivium platonis, De Amore, texte établi et traduit par Pierre
Laurens, Paris, Les Belles Lettres, 2002.
GUICHARNAUD, Jacques, Molière, une aventure théâtrale. Tartuffe - Dom Juan -
Le Misanthrope, Paris, Gallimard, 1964.
PLATON, Le Banquet, éd. Léon Robin, dans Œuvres complètes de Platon, tome
IV, 2e partie, Paris, Les Belles Lettres, 1929, p. 1-92,
https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Banquet_(trad._Robin)
Corneille, La Place royale, Le Menteur, La Suite du Menteur, Clamecy, Atlande,
2024 (Partie PROBLÉMATIQUES, ch. 2 et ch. 5)
L. Picciola, « La distanciation à l’espagnole revisitée par Corneille », article issu
de la communication donnée dans le cadre de la Journée d'études d'agrégation sur
le 9 nov. 2024, à paraître dans la revue Corneille présent, no 3. L’annonce sera
faite sur le site du Mouvement Corneille, à surveiller donc, à l’adresse suivante :
https://corneille.hypotheses.org/DOCUMENTATION
Doc 1. L’histoire de Célidée (L’Astrée, II, 1)
Que c’est une douce chose que d’être belle ! Mais combien plus amers sont les effets qui s’en
produisent, et qu’il m’est impossible d’éviter en vous conservant. Quoi donc ? que l’amour suit
la beauté, et que rien n’est plus agréable que d’être aimée et caressée ? […] Ne dis-tu pas
qu’au lieu que chacun m’adorait belle, chacun me méprisera laide. […] Cette action si peu
accoutumée me fera admirer, et contraindra chacun de croire qu’il y a quelque perfection cachée
en moi, plus puissante que ceste beauté qui se voyait. Et puis, ce que je desseigne de faire, n’est
que de devancer le temps de fort peu de moments. …Car cette beauté dont nous faisons tant de
conte, combien de lunes me pourrait-elle demeurer encore : fort peu certes, et quelque soin et
quelque peine que j’y rapporte, il faut que l’âge me la ravisse, et ne vaut-il pas mieux que pour
une si bonne occasion, nous nous en dépouillons nous-mêmes volontairement, et la sacrifions
au repos de Thamire, que j’aime, et que j’ai tant d’occasion d’aimer, et à celui de Calidon, qui
a tant souffert de peines, pour l’affection qu’il m’a portée ? Au pis aller que m’en adviendra il ?
Quand je serai laide : moins de personnes m’aimeront, et de qui dois-je vouloir l’amitié que de
Thamyre ? […]
À ces mots dis-je Célidée met la pointe du diamant à son front, et d’une main généreuse se
l’enfonça dans la peau, et quoique la douleur fut extrême, si se le coupe-t-elle d’un côté à l’autre,
et grinçant les dents du mal que la blessure lui faisait, elle en fait de même à ses joues, et se fait
de chaque côté trois ou quatre profondes cicatrices si longues et si enfoncées, que véritablement
il ne lui restait plus rien de la beauté qu’elle soulait avoir.
[…]
Il est advenu que véritablement Calidon la voyant si difforme, a perdu cette folle passion qu’il
lui portait, et que Thamire ainsi qu’elle espérait a continué de l’aimer
si bien qu’elle a depuis vécu en repos, et tellement honorée et estimée de chacun, qu’elle jure
n’avoir reçu de sa beauté en toute sa vie, la moindre partie du contentement que sa laideur lui a
rapporté depuis dix ou douze nuits
Doc. 2 Histoire de Dorinde et de Périandre (L’Astrée, IV, 2)
Eh ! ma fille, répliqua Périandre, tu te trompes, ou tu te moques de moi, elle* est morte pour
certain, mais on m’a bien dit que mourant elle a laissé en sa place une certaine laide fille que
pour l’amour d’elle l’on a nommée Dorinde, mais la belle Dorinde que j’aimais est assurément
morte, et j’en ay eu tant de regret que je ne veux point aller voir cette-ci pour n’avoir occasion
de pleurer encore l’autre, pour laquelle j’ay jeté tant de larmes. - Et quoi Périandre, reprit la
fille toute étonnée de cette réponse, vous ne vous contentez pas de vous séparer d’amitié, mais
encore vous vous moquez du mal de Dorinde.
- Dorinde, reprit-il incontinent, comme je te dis,
n’est plus au monde, et que voudrais tu que je l’allasse aimer dans le cercueil ? Et quant à celle
qui est en sa place, ha ! ma fille, elle est si laide que je la quitte à qui la voudra ; et à ce mot,
sans attendre autre réponse, il s’en alla d’un autre côté.
*DorindeDoc. 3 Les extravagants anti-précieux ; débats idéalistes plaisants (l’Astrée, II, 6)
Et quoi ? répliqua l’inconstant, on verrait Hylas amoureux d’un tombeau ? Et si j’avois la
jouissance de mes amours, comme en fin tout amant la désire, qu’en naîtrait-il, Tircis, que des
cercueils ? Quant à moi, Berger, je ne veux point de tels enfants, et par conséquent n’aimerai
jamais telles maîtresses. Mais venons à la raison. Quel contentement et quelle fin proposez-
vous à votre amour ? - Amour, dit-il, est un si grand Dieu, qu’il ne peut rien désirer hors de soi-
même : il est son propre centre : et n’a jamais dessein qui ne commence et finisse en lui. Et
partant Hylas, quand il se propose quelque contentement, c’est en lui-même d’où il ne peut
sortir, étant un cercle rond qui par tout a sa fin et son commencement, voire qui commence ou
il finit se perpétuant de cette sorte, non point par l’entremise de quelque autre, mais par sa seule
et propre nature. - C’est bien Druiser, dit Hylas, en se moquant, mais quant à moi, je crois que
tout ce que vous venez de dire sont des fables avec lesquelles les femmes endorment les moins
ruseés. - Et qu’est-ce, Hylas, dit Tircis, qui te semble plus éloigné de la vérité ? - Toutes les
choses que vous venez de dire, répondit l’inconstant, sont de telle sorte hors d’apparence, que
je ne saurais marquer celle qui l’est davantage. Qu’Amour ne désire rien hors de soi-même ;
tant s’en faut on voit le contraire, puis que nous ne désirons que ce que nous n’avons pas. - Si
vous entendiez, répondit Tircis, de quelle sorte par l’infinie puissance d’amour deux personnes
ne deviennent qu’une, et une en devient deux, vous connaîtrez que l’amant ne peut rien désirer
hors de soi-même. Car aussitôt que vous auriez entendu comme l’amant se transforme en
l’aimé, et l’aimé en l’amant, et par ainsi deux ne deviennent qu’un, et chacun toutesfois étant
Amant et Aimé, par conséquent est deux, vous comprendriez, Hylas, ce qui vous est tant
difficile, et avoueriez, que puisqu’il ne désire que ce qu’il aime, et qu’il est l’Amant et l’Aimé,
ses désirs ne peuvent sortir de lui-même. - Voici bien, dit Hylas, la preuve du vieux proverbe,
Qu’une erreur en attire cent. Car pour me persuader ce que vous avez dict, vous m’allez figurant
des choses encore plus impossibles, à savoir, que celui qui aime, devient ce qu’il aime, et par
ainsi je serais donc Philis. - La conclusion, dit Silvandre, n’est pas bonne : car vous ne l’aimez
pas, mais si vous disiez qu’en aimant Diane, je me transforme en elle, vous diriez fort bien. -
Et quoi, dit Hylas, vous êtes donc Diane ? Et votre chapeau aussi n’est-il point changé en sa
coiffure, et votre jupe en sa robe ? - Mon chapeau, dit Silvandre, n’aime pas sa coiffure. - Mais
quoi ? dit l’inconstant, vous devriez donc vous habiller en fille : car il n’est pas raisonnable
qu’une sage Bergère comme vous êtes, se déguise de te sorte en homme. Il n’y eut personne de
la troupe qui se peut empêcher de rire des paroles de ce Berger, et Silvandre même en rit comme
les autres : mais après il répondit de cette sorte : - Il faut s’il m’est possible que je vous sorte de
l’erreur où vous êtes. Sachez donc qu’il y a deux parties en l’homme, l’une ce corps que nous
voyons, et que nous touchons, et l’autre l’âme qui ne se voit, ni ne se touche point, mais se
reconnaît par les paroles et par les actions, car les actions ni les paroles ne sont point du corps,
mais de l’âme, qui toutefois se sert du corps, comme d’un instrument. Or le corps ne voit ni
n’entend : mais c’est l’âme qui fait toutes ces choses : de sorte que quand nous aimons ce n’est
pas le corps, qui aime, mais l’âme, et ainsi ce n’est que l’âme qui se transforme en la chose
aimée, et non pas le corps. - Mais, interrompit Hylas, j’aime le corps aussi bien que l’âme : de
sorte que si l’amant se change en l’aimé, mon âme devrait se changer aussi bien au corps de
Philis qu’en son âme. - Cela, dit Silvandre serait contrevenir aux loix de la nature : car l’âme
qui est spirituelle, ne peut non plus devenir corps, que le corps devenir âme : mais pour cela le
changement de l’amant en l’aimé ne laisse pas de se faire. - Ce n’est donc qu’en une partie, dit
Hylas, qui est l’âme, et qui par conséquent est celle dont je me soucie le moins. - En cela vous
faites paraître, dit Silvandre, que vous n’aimez point, ou que vous aimez contre la raison : car
l’âme ne se doit point abaisser à ce qui est moins qu’elle, et c’est pourquoi on dit que l’amour
doit être entre les égaux, à savoir l’âme, aimer l’âme qui est son égale, et non pas le corps quiest son inferieur, et que la nature ne lui a donné que pour instrument. Or pour faire paraître que
l’amant devient l’aimé, et que si vous aimiez bien Philis, Hylas serait Philis, et si Philis aimait
bien Hylas, Philis serait Hylas, oyez que c’est que l’âme : car ce n’est rien, Berger, qu’une
volonté, qu’une mémoire, et qu’un entendement. Or si les plus savants disent que nous ne
pouvons aimer que ce que nous connaissons, et s’il est vrai que l’entendement et la chose
entendue ne sont qu’une même chose, il s’ensuit que l’entendement de celui qui aime est le
même qu’il aime. Que si la volonté de l’amant ne doit en rien différer de celle de l’aimé, et s’il
vit plus par la pensée qui n’est qu’un effet de la mémoire, que par la propre vie qu’il respire,
qui doutera que la mémoire, l’entendement et la volonté étant changée en ce qu’il aime, son
âme qui n’est autre chose que ces trois puissances, ne le soit de même ? - Par Thautatès, dit
Hylas, vous le prenez bien haut, encor que j’aie longtemps été dans les écoles des Massiliens,
si ne puis-je qu’à peine vous suivre. - Si est-ce, dit Silvandre, que c’est parmi eux que j’ai appris
ce que je dis. - Si avez-vous eu beau m’embrouiller le cerveau par vos discours, dit Hylas, vous
ne sauriez pourtant me montrer que l’amant se change en l’aimé, puis qu’il en laisse une partie,
qui est le corps. - Le corps, dit Silvandre, n’est pas partie, mais instrument de l’aimé, et de fait
si l’âme était séparée du corps de Philis, ne dirait-on pas, voilà le corps de Philis ? Que si c’est
bien parler que de dire ainsi, il faut donc entendre que Philis est ailleurs, et ce serait en cette
Philis que vous seriez transformé, si vous saviez bien aimer, et cela étant, vous n’auriez point
de désir hors de vous-même : car comprenant toute votre amour en vous, vous assouviriez aussi
en vous tous vos désirs. - S’il est vrai, dit Hylas, que le corps ne soit que l’instrument dont se
sert Philis, je vous donne Philis, et laissez-moi le reste, et nous verrons qui sera plus content de
vous ou de moi : Et pour la fin de notre différent, il sera fort à propos que nous dormions un
peu. Et à ce mot se remettant en sa place, ne voulut plus leur répondre. Ainsi peu à peu toute
cette troupe s’endormit hormis Silvandre, qui véritablement épris d’une tré-violente affection,
ne peut clore l’œil de longtemps après.
DOC 4 . LE NÉOPLATONISME
4a Le druide Adamas (l’Astrée)
Il faut donc que vous sachiez que toute beauté procède de cette souveraine bonté, que nous
appelons Dieu, et que c’est un rayon qui s’élance de lui sur toutes les choses créées (II, 2)
Sachez donc qu’il y a deux parties en l’homme : l’une, ce corps que nous voyons, et que nous
touchons, et l’autre, l’âme qui ne se voit ni ne se touche point, mais se reconnaît par les paroles
et par les actions, car les actions ni les paroles ne sont point du corps, mais de l’âme, qui
toutefois se sert du corps, comme d’un instrument. Or le corps ne voit ni n’entend, mais c’est
l’âme qui fait toutes ces choses. (II, 6)
4b Un berger idéaliste : le Tircis de l’Astrée
Si vous entendiez, répondit Tircis, de quelle sorte par l’infinie puissance d’amour deux
personnes ne deviennent qu’une, et une en devient deux, [...] vous auriez entendu comme
l’amant se transforme en l’aimé, et l’aimé en l’amant, et par ainsi deux ne deviennent qu’un, et
chacun toutefois, étant amant et aimé, par conséquent est deux […] Savez-vous bien que c’est
qu’aimer, c’est mourir en soi, pour revivre en autrui, c’est ne se point aimer que d’autant que
l’on est agréable à la chose aimée : & bref c’est une volonté de se transformer, s’il se peut
entièrement en elle*. (II, 6)
*À mettre en rapport avec le document 3. Silvandre et Tircis sont proches par la pensée.4c Texte inspirateur « moderne »
Marsile FICIN (1433-1499), Commentaires sur le Banque (Commentarium in convivium
Platonis, Florence,1469) II, 9, trad. Pierre Laurens, 2002 (NB. 1e traduction en français en
1545)
Au reste, que cherchent-ils, ceux qui s’aiment d’un amour partagé ? Ils cherchent la Beauté.
Car l’Amour est désir de jouir de la Beauté. Et la Beauté, une splendeur qui ravit à elle l’âme
humaine. La beauté du corps n’est rien d’autre que cette splendeur manifeste dans le charme
des couleurs et des lignes. La beauté de l’âme aussi, splendeur fulgurante dans l’harmonie de
la doctrine et des mœurs. Cette lumière du corps, ce n’est point les oreilles, l’odorat, le goût, le
toucher, mais l’œil qui la perçoit. Mais si l’œil est seul à la percevoir, il est seul à en jouir. L’œil
est donc seul à jouir de la beauté corporelle. Et puisque l’amour n’est rien d’autre que le désir
de jouir de la beauté, et que seuls les yeux peuvent la saisir, celui qui aime le corps est comblé
par la seule vision. Quant au désir de toucher, ce n’est point une composante de l’amour ni un
affect de l’amant, mais une sorte d’emportement et un désordre indigne d’un homme libre.
L’autre lumière et beauté, celle de l’âme, nous ne la saisissons que par l’esprit. Aussi est comblé
par la seule vue de l’intelligence celui qui recherche la beauté de l’âme. Enfin il y a entre les
amants échange de beauté. L’homme fait jouir par les yeux de la beauté du plus jeune. Le plus
jeune atteint par l’esprit la beauté de l’homme fait. Qui n’est beau que de corps acquiert grâce
à ce commerce la beauté de l’âme et qui n’est beau que de l’âme rassasie de beauté corporelle
les yeux du corps. Échange merveilleux, honnête, utile et agréable à tous deux. Aussi honnête
pour l’un que pour l’autre, car il est honnête d’apprendre, comme d’enseigner. Plus agréable
pour le plus âgé, qui se délecte par la vue et par l’intelligence, mais plus utile pour le jeune
homme, car, autant l’âme est supérieure au corps, autant l’acquisition de la beauté de l’âme est
plus précieuse que celle du corps.
4d Texte inspirateur « antique »
Platon, Le Banquet, 208 e – 211 c, traduction Léon Robin
SOCRATE. Ce qu’il faut, quand on va par la bonne voie à ce but, c’est en vérité de commencer
dès le jeune âge à s’orienter vers la beauté corporelle[…] Après quoi, c’est la beauté dans les
âmes qu’il estimera plus précieuse que celle qui appartient au corps : au point que, s’il advient
qu’une gentille âme se trouve en un corps dont la fleur n’a point d’éclat, il se satisfait d’aimer
cette âme, de s’y intéresser et d’enfanter de semblables discours, comme d’en chercher qui
rendront la jeunesse meilleure; et c’est assez pour le contraindre maintenant d’envisager ce qu’il
y a de beau dans les occupations et dans les règles de conduite; c’est même assez d’avoir aperçu
la parenté qui à soi-même unit tout cela, pour que désormais la beauté corporelle ne tienne
qu’une petite place dans son estime !
Doc 5 Les aimants : la théorie de Silvandre (l’Astrée, I, 10)
Il dit que quand le grand Dieu forma toutes nos âmes, il les toucha chacun avec une pièce
d’aimant, et qu’après il mit toutes ces pièces dans un lieu à part, et que de même, celles des
femmes, après les avoir touchées, il les serra en un autre magasin séparé. Que depuis, quand il
envoie les âmes dans les corps, il mène celles des femmes où sont les pierres d’aimant qui ont
touché celles des hommes, et celles des hommes à celles des femmes, et leur en fait prendre
une à chacune […]. Il advient de là qu’aussitôt que l’âme est dans le corps et qu’elle rencontre
celle qui a son aimant, il lui est impossible qu’elle ne l’aime, et d’ici procèdent tous les effets
de l’Amour ; car quant à celles qui sont aimées de plusieurs, c’est qu’elles ont été larronnesses
et ont pris plusieurs pièces. Quant à celle qui aime quelqu’un qui ne l’aime point, c’est que
celui-là a son aimant, et non pas elle le sien.Doc 6 Le vieux saule (l’Astrée, I, 4)
Et parce que nous avions coutume de nous écrire tous les jours pour être quelquefois empêchés,
et ne pouvoir venir en ce lieu, nous avions choisi le long de ce petit ruisseau qui côtoie la grand
allée, un vieux saule mi-mangé de vieillesse, dans le creux duquel nous mettions tous les jours
des lettres ; afin de pouvoir plus aisément faire réponse, nous y laissions ordinairement une
écritoire. […]
Or depuis ce temps nous allâmes un peu plus retenus que de coutume, mais au sortir de ce
travail je rentrai en une autre qui n’était guère moindre, car nous ne pûmes si bien dissimuler,
qu’Alcippe, qui y prenait garde, ne reconnût que l’affection de son fils envers moi n’était pas
du tout éteinte, et pour s’en assurer, il veilla si bien ses actions, que remarquant avec
quelle curiosité il allait tous les jours à ce vieil saule, où nous mettions nos lettres, un matin il
s’y en alla le premier, après avoir longuement cherché prenant garde à la foulure que nous
avions faite sur l’herbe pour y être allez si souvent, il se laissa conduire, et le trac le mena droit
au pied de l’arbre, où il trouva une lettre que j’y avois mise le soir
A. PLAN D’ÉTUDE
UNE DRAMATURGIE COMIQUE DE LA PRÉCIOSITÉ :
LA SUITE DU MENTEUR
I . De La Place royale au Menteur : nature des contributions de la
préciosité au genre comique
1. Alidor, l’anti-précieux. L’étonnement et l’extravagance comme
composantes d’une comédie (doc. 1 et doc 2)
2. Philis, le comique d’une précieuse joueuse : entre connivence et
comique relatif
3. Dorante et Clarice : des débatteurs précieux ? La conjouissance
amusée (doc. 3)
II. La préciosité de La Suite du Menteur : les délices de la
stupéfaction
1. L’insertion de la pensée précieuse dans La Suite (docs 4a, 4b, 4c, 4d sur
le néoplatonisme)
2. Le rire d’émerveillement devant les symétries précieuses (doc 4c)
3. La présence associée d’un comique de caractère
III. La variété des rires provoqués par les serviteurs dans La Suite
du Menteur
1. La grâce de la complicité et de la distanciation (doc. 5 ; doc 6)
2. Comiques de gestes et de situation : de l’étonnement à la parodie
3. Le faux comique de caractère de Cliton : terre-à-terre contre
idéalisme ? (doc 4c)B. SOURCES
D’URFÉ, Honoré, L’Astrée, éd. Delphine Denis et alii, Partie I, Partie II, Partie III,
Paris, Honoré Champion, respectivement 2011, 2016, 2022.
D’URFÉ, Honoré, L’Astrée, Première partie, édition critique établie sous la
direction de Delphine Denis, Paris, Honoré Champion, « Champion Classiques
Littératures », n°18, 2011.
Deux visages de l’Astrée, éd. Eglal Henein, https://astree.tufts.edu/
BAUDELAIRE, De l’essence du rire et généralement du comique dans les arts
plastiques, dans Œuvres complètes, éd. M. A. Ruff, Paris, Éditions du Seuil,
L’Intégrale, 1968, p. 370-378.
DUFOUR-MAÎTRE, Myriam, « L’invention de la préciosité », BNF, Les Essentiels,
2023, https://essentiels.bnf.fr/fr/article/47904be5-24e3-4748-ae7f-f073fd4bc50c-
invention-la-preciosite
EDWARDS, Michaël, “Le rire shakespearienˮ, Revue de la BNF, 2011/2 (n° 38),
p. 44-50. DOI : 10.3917/rbnf.038.0044. URL : https://www.cairn.info/revue-de-
la-bibliotheque-nationale-de-france-2011-2-page-44.htm
FICIN, Marsile, Commentaire sur le Banquet de Platon, De l'amour /
Commentarium in convivium platonis, De Amore, texte établi et traduit par Pierre
Laurens, Paris, Les Belles Lettres, 2002.
GUICHARNAUD, Jacques, Molière, une aventure théâtrale. Tartuffe - Dom Juan -
Le Misanthrope, Paris, Gallimard, 1964.
PLATON, Le Banquet, éd. Léon Robin, dans Œuvres complètes de Platon, tome
IV, 2e partie, Paris, Les Belles Lettres, 1929, p. 1-92,
https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Banquet_(trad._Robin)
Corneille, La Place royale, Le Menteur, La Suite du Menteur, Clamecy, Atlande,
2024 (Partie PROBLÉMATIQUES, ch. 2 et ch. 5)
L. Picciola, « La distanciation à l’espagnole revisitée par Corneille », article issu
de la communication donnée dans le cadre de la Journée d'études d'agrégation sur
le 9 nov. 2024, à paraître dans la revue Corneille présent, no 3. L’annonce sera
faite sur le site du Mouvement Corneille, à surveiller donc, à l’adresse suivante :
https://corneille.hypotheses.org/DOCUMENTATION
Doc 1. L’histoire de Célidée (L’Astrée, II, 1)
Que c’est une douce chose que d’être belle ! Mais combien plus amers sont les effets qui s’en
produisent, et qu’il m’est impossible d’éviter en vous conservant. Quoi donc ? que l’amour suit
la beauté, et que rien n’est plus agréable que d’être aimée et caressée ? […] Ne dis-tu pas
qu’au lieu que chacun m’adorait belle, chacun me méprisera laide. […] Cette action si peu
accoutumée me fera admirer, et contraindra chacun de croire qu’il y a quelque perfection cachée
en moi, plus puissante que ceste beauté qui se voyait. Et puis, ce que je desseigne de faire, n’est
que de devancer le temps de fort peu de moments. …Car cette beauté dont nous faisons tant de
conte, combien de lunes me pourrait-elle demeurer encore : fort peu certes, et quelque soin et
quelque peine que j’y rapporte, il faut que l’âge me la ravisse, et ne vaut-il pas mieux que pour
une si bonne occasion, nous nous en dépouillons nous-mêmes volontairement, et la sacrifions
au repos de Thamire, que j’aime, et que j’ai tant d’occasion d’aimer, et à celui de Calidon, qui
a tant souffert de peines, pour l’affection qu’il m’a portée ? Au pis aller que m’en adviendra il ?
Quand je serai laide : moins de personnes m’aimeront, et de qui dois-je vouloir l’amitié que de
Thamyre ? […]
À ces mots dis-je Célidée met la pointe du diamant à son front, et d’une main généreuse se
l’enfonça dans la peau, et quoique la douleur fut extrême, si se le coupe-t-elle d’un côté à l’autre,
et grinçant les dents du mal que la blessure lui faisait, elle en fait de même à ses joues, et se fait
de chaque côté trois ou quatre profondes cicatrices si longues et si enfoncées, que véritablement
il ne lui restait plus rien de la beauté qu’elle soulait avoir.
[…]
Il est advenu que véritablement Calidon la voyant si difforme, a perdu cette folle passion qu’il
lui portait, et que Thamire ainsi qu’elle espérait a continué de l’aimer
si bien qu’elle a depuis vécu en repos, et tellement honorée et estimée de chacun, qu’elle jure
n’avoir reçu de sa beauté en toute sa vie, la moindre partie du contentement que sa laideur lui a
rapporté depuis dix ou douze nuits
Doc. 2 Histoire de Dorinde et de Périandre (L’Astrée, IV, 2)
Eh ! ma fille, répliqua Périandre, tu te trompes, ou tu te moques de moi, elle* est morte pour
certain, mais on m’a bien dit que mourant elle a laissé en sa place une certaine laide fille que
pour l’amour d’elle l’on a nommée Dorinde, mais la belle Dorinde que j’aimais est assurément
morte, et j’en ay eu tant de regret que je ne veux point aller voir cette-ci pour n’avoir occasion
de pleurer encore l’autre, pour laquelle j’ay jeté tant de larmes. - Et quoi Périandre, reprit la
fille toute étonnée de cette réponse, vous ne vous contentez pas de vous séparer d’amitié, mais
encore vous vous moquez du mal de Dorinde.
- Dorinde, reprit-il incontinent, comme je te dis,
n’est plus au monde, et que voudrais tu que je l’allasse aimer dans le cercueil ? Et quant à celle
qui est en sa place, ha ! ma fille, elle est si laide que je la quitte à qui la voudra ; et à ce mot,
sans attendre autre réponse, il s’en alla d’un autre côté.
*DorindeDoc. 3 Les extravagants anti-précieux ; débats idéalistes plaisants (l’Astrée, II, 6)
Et quoi ? répliqua l’inconstant, on verrait Hylas amoureux d’un tombeau ? Et si j’avois la
jouissance de mes amours, comme en fin tout amant la désire, qu’en naîtrait-il, Tircis, que des
cercueils ? Quant à moi, Berger, je ne veux point de tels enfants, et par conséquent n’aimerai
jamais telles maîtresses. Mais venons à la raison. Quel contentement et quelle fin proposez-
vous à votre amour ? - Amour, dit-il, est un si grand Dieu, qu’il ne peut rien désirer hors de soi-
même : il est son propre centre : et n’a jamais dessein qui ne commence et finisse en lui. Et
partant Hylas, quand il se propose quelque contentement, c’est en lui-même d’où il ne peut
sortir, étant un cercle rond qui par tout a sa fin et son commencement, voire qui commence ou
il finit se perpétuant de cette sorte, non point par l’entremise de quelque autre, mais par sa seule
et propre nature. - C’est bien Druiser, dit Hylas, en se moquant, mais quant à moi, je crois que
tout ce que vous venez de dire sont des fables avec lesquelles les femmes endorment les moins
ruseés. - Et qu’est-ce, Hylas, dit Tircis, qui te semble plus éloigné de la vérité ? - Toutes les
choses que vous venez de dire, répondit l’inconstant, sont de telle sorte hors d’apparence, que
je ne saurais marquer celle qui l’est davantage. Qu’Amour ne désire rien hors de soi-même ;
tant s’en faut on voit le contraire, puis que nous ne désirons que ce que nous n’avons pas. - Si
vous entendiez, répondit Tircis, de quelle sorte par l’infinie puissance d’amour deux personnes
ne deviennent qu’une, et une en devient deux, vous connaîtrez que l’amant ne peut rien désirer
hors de soi-même. Car aussitôt que vous auriez entendu comme l’amant se transforme en
l’aimé, et l’aimé en l’amant, et par ainsi deux ne deviennent qu’un, et chacun toutesfois étant
Amant et Aimé, par conséquent est deux, vous comprendriez, Hylas, ce qui vous est tant
difficile, et avoueriez, que puisqu’il ne désire que ce qu’il aime, et qu’il est l’Amant et l’Aimé,
ses désirs ne peuvent sortir de lui-même. - Voici bien, dit Hylas, la preuve du vieux proverbe,
Qu’une erreur en attire cent. Car pour me persuader ce que vous avez dict, vous m’allez figurant
des choses encore plus impossibles, à savoir, que celui qui aime, devient ce qu’il aime, et par
ainsi je serais donc Philis. - La conclusion, dit Silvandre, n’est pas bonne : car vous ne l’aimez
pas, mais si vous disiez qu’en aimant Diane, je me transforme en elle, vous diriez fort bien. -
Et quoi, dit Hylas, vous êtes donc Diane ? Et votre chapeau aussi n’est-il point changé en sa
coiffure, et votre jupe en sa robe ? - Mon chapeau, dit Silvandre, n’aime pas sa coiffure. - Mais
quoi ? dit l’inconstant, vous devriez donc vous habiller en fille : car il n’est pas raisonnable
qu’une sage Bergère comme vous êtes, se déguise de te sorte en homme. Il n’y eut personne de
la troupe qui se peut empêcher de rire des paroles de ce Berger, et Silvandre même en rit comme
les autres : mais après il répondit de cette sorte : - Il faut s’il m’est possible que je vous sorte de
l’erreur où vous êtes. Sachez donc qu’il y a deux parties en l’homme, l’une ce corps que nous
voyons, et que nous touchons, et l’autre l’âme qui ne se voit, ni ne se touche point, mais se
reconnaît par les paroles et par les actions, car les actions ni les paroles ne sont point du corps,
mais de l’âme, qui toutefois se sert du corps, comme d’un instrument. Or le corps ne voit ni
n’entend : mais c’est l’âme qui fait toutes ces choses : de sorte que quand nous aimons ce n’est
pas le corps, qui aime, mais l’âme, et ainsi ce n’est que l’âme qui se transforme en la chose
aimée, et non pas le corps. - Mais, interrompit Hylas, j’aime le corps aussi bien que l’âme : de
sorte que si l’amant se change en l’aimé, mon âme devrait se changer aussi bien au corps de
Philis qu’en son âme. - Cela, dit Silvandre serait contrevenir aux loix de la nature : car l’âme
qui est spirituelle, ne peut non plus devenir corps, que le corps devenir âme : mais pour cela le
changement de l’amant en l’aimé ne laisse pas de se faire. - Ce n’est donc qu’en une partie, dit
Hylas, qui est l’âme, et qui par conséquent est celle dont je me soucie le moins. - En cela vous
faites paraître, dit Silvandre, que vous n’aimez point, ou que vous aimez contre la raison : car
l’âme ne se doit point abaisser à ce qui est moins qu’elle, et c’est pourquoi on dit que l’amour
doit être entre les égaux, à savoir l’âme, aimer l’âme qui est son égale, et non pas le corps quiest son inferieur, et que la nature ne lui a donné que pour instrument. Or pour faire paraître que
l’amant devient l’aimé, et que si vous aimiez bien Philis, Hylas serait Philis, et si Philis aimait
bien Hylas, Philis serait Hylas, oyez que c’est que l’âme : car ce n’est rien, Berger, qu’une
volonté, qu’une mémoire, et qu’un entendement. Or si les plus savants disent que nous ne
pouvons aimer que ce que nous connaissons, et s’il est vrai que l’entendement et la chose
entendue ne sont qu’une même chose, il s’ensuit que l’entendement de celui qui aime est le
même qu’il aime. Que si la volonté de l’amant ne doit en rien différer de celle de l’aimé, et s’il
vit plus par la pensée qui n’est qu’un effet de la mémoire, que par la propre vie qu’il respire,
qui doutera que la mémoire, l’entendement et la volonté étant changée en ce qu’il aime, son
âme qui n’est autre chose que ces trois puissances, ne le soit de même ? - Par Thautatès, dit
Hylas, vous le prenez bien haut, encor que j’aie longtemps été dans les écoles des Massiliens,
si ne puis-je qu’à peine vous suivre. - Si est-ce, dit Silvandre, que c’est parmi eux que j’ai appris
ce que je dis. - Si avez-vous eu beau m’embrouiller le cerveau par vos discours, dit Hylas, vous
ne sauriez pourtant me montrer que l’amant se change en l’aimé, puis qu’il en laisse une partie,
qui est le corps. - Le corps, dit Silvandre, n’est pas partie, mais instrument de l’aimé, et de fait
si l’âme était séparée du corps de Philis, ne dirait-on pas, voilà le corps de Philis ? Que si c’est
bien parler que de dire ainsi, il faut donc entendre que Philis est ailleurs, et ce serait en cette
Philis que vous seriez transformé, si vous saviez bien aimer, et cela étant, vous n’auriez point
de désir hors de vous-même : car comprenant toute votre amour en vous, vous assouviriez aussi
en vous tous vos désirs. - S’il est vrai, dit Hylas, que le corps ne soit que l’instrument dont se
sert Philis, je vous donne Philis, et laissez-moi le reste, et nous verrons qui sera plus content de
vous ou de moi : Et pour la fin de notre différent, il sera fort à propos que nous dormions un
peu. Et à ce mot se remettant en sa place, ne voulut plus leur répondre. Ainsi peu à peu toute
cette troupe s’endormit hormis Silvandre, qui véritablement épris d’une tré-violente affection,
ne peut clore l’œil de longtemps après.
DOC 4 . LE NÉOPLATONISME
4a Le druide Adamas (l’Astrée)
Il faut donc que vous sachiez que toute beauté procède de cette souveraine bonté, que nous
appelons Dieu, et que c’est un rayon qui s’élance de lui sur toutes les choses créées (II, 2)
Sachez donc qu’il y a deux parties en l’homme : l’une, ce corps que nous voyons, et que nous
touchons, et l’autre, l’âme qui ne se voit ni ne se touche point, mais se reconnaît par les paroles
et par les actions, car les actions ni les paroles ne sont point du corps, mais de l’âme, qui
toutefois se sert du corps, comme d’un instrument. Or le corps ne voit ni n’entend, mais c’est
l’âme qui fait toutes ces choses. (II, 6)
4b Un berger idéaliste : le Tircis de l’Astrée
Si vous entendiez, répondit Tircis, de quelle sorte par l’infinie puissance d’amour deux
personnes ne deviennent qu’une, et une en devient deux, [...] vous auriez entendu comme
l’amant se transforme en l’aimé, et l’aimé en l’amant, et par ainsi deux ne deviennent qu’un, et
chacun toutefois, étant amant et aimé, par conséquent est deux […] Savez-vous bien que c’est
qu’aimer, c’est mourir en soi, pour revivre en autrui, c’est ne se point aimer que d’autant que
l’on est agréable à la chose aimée : & bref c’est une volonté de se transformer, s’il se peut
entièrement en elle*. (II, 6)
*À mettre en rapport avec le document 3. Silvandre et Tircis sont proches par la pensée.4c Texte inspirateur « moderne »
Marsile FICIN (1433-1499), Commentaires sur le Banque (Commentarium in convivium
Platonis, Florence,1469) II, 9, trad. Pierre Laurens, 2002 (NB. 1e traduction en français en
1545)
Au reste, que cherchent-ils, ceux qui s’aiment d’un amour partagé ? Ils cherchent la Beauté.
Car l’Amour est désir de jouir de la Beauté. Et la Beauté, une splendeur qui ravit à elle l’âme
humaine. La beauté du corps n’est rien d’autre que cette splendeur manifeste dans le charme
des couleurs et des lignes. La beauté de l’âme aussi, splendeur fulgurante dans l’harmonie de
la doctrine et des mœurs. Cette lumière du corps, ce n’est point les oreilles, l’odorat, le goût, le
toucher, mais l’œil qui la perçoit. Mais si l’œil est seul à la percevoir, il est seul à en jouir. L’œil
est donc seul à jouir de la beauté corporelle. Et puisque l’amour n’est rien d’autre que le désir
de jouir de la beauté, et que seuls les yeux peuvent la saisir, celui qui aime le corps est comblé
par la seule vision. Quant au désir de toucher, ce n’est point une composante de l’amour ni un
affect de l’amant, mais une sorte d’emportement et un désordre indigne d’un homme libre.
L’autre lumière et beauté, celle de l’âme, nous ne la saisissons que par l’esprit. Aussi est comblé
par la seule vue de l’intelligence celui qui recherche la beauté de l’âme. Enfin il y a entre les
amants échange de beauté. L’homme fait jouir par les yeux de la beauté du plus jeune. Le plus
jeune atteint par l’esprit la beauté de l’homme fait. Qui n’est beau que de corps acquiert grâce
à ce commerce la beauté de l’âme et qui n’est beau que de l’âme rassasie de beauté corporelle
les yeux du corps. Échange merveilleux, honnête, utile et agréable à tous deux. Aussi honnête
pour l’un que pour l’autre, car il est honnête d’apprendre, comme d’enseigner. Plus agréable
pour le plus âgé, qui se délecte par la vue et par l’intelligence, mais plus utile pour le jeune
homme, car, autant l’âme est supérieure au corps, autant l’acquisition de la beauté de l’âme est
plus précieuse que celle du corps.
4d Texte inspirateur « antique »
Platon, Le Banquet, 208 e – 211 c, traduction Léon Robin
SOCRATE. Ce qu’il faut, quand on va par la bonne voie à ce but, c’est en vérité de commencer
dès le jeune âge à s’orienter vers la beauté corporelle[…] Après quoi, c’est la beauté dans les
âmes qu’il estimera plus précieuse que celle qui appartient au corps : au point que, s’il advient
qu’une gentille âme se trouve en un corps dont la fleur n’a point d’éclat, il se satisfait d’aimer
cette âme, de s’y intéresser et d’enfanter de semblables discours, comme d’en chercher qui
rendront la jeunesse meilleure; et c’est assez pour le contraindre maintenant d’envisager ce qu’il
y a de beau dans les occupations et dans les règles de conduite; c’est même assez d’avoir aperçu
la parenté qui à soi-même unit tout cela, pour que désormais la beauté corporelle ne tienne
qu’une petite place dans son estime !
Doc 5 Les aimants : la théorie de Silvandre (l’Astrée, I, 10)
Il dit que quand le grand Dieu forma toutes nos âmes, il les toucha chacun avec une pièce
d’aimant, et qu’après il mit toutes ces pièces dans un lieu à part, et que de même, celles des
femmes, après les avoir touchées, il les serra en un autre magasin séparé. Que depuis, quand il
envoie les âmes dans les corps, il mène celles des femmes où sont les pierres d’aimant qui ont
touché celles des hommes, et celles des hommes à celles des femmes, et leur en fait prendre
une à chacune […]. Il advient de là qu’aussitôt que l’âme est dans le corps et qu’elle rencontre
celle qui a son aimant, il lui est impossible qu’elle ne l’aime, et d’ici procèdent tous les effets
de l’Amour ; car quant à celles qui sont aimées de plusieurs, c’est qu’elles ont été larronnesses
et ont pris plusieurs pièces. Quant à celle qui aime quelqu’un qui ne l’aime point, c’est que
celui-là a son aimant, et non pas elle le sien.Doc 6 Le vieux saule (l’Astrée, I, 4)
Et parce que nous avions coutume de nous écrire tous les jours pour être quelquefois empêchés,
et ne pouvoir venir en ce lieu, nous avions choisi le long de ce petit ruisseau qui côtoie la grand
allée, un vieux saule mi-mangé de vieillesse, dans le creux duquel nous mettions tous les jours
des lettres ; afin de pouvoir plus aisément faire réponse, nous y laissions ordinairement une
écritoire. […]
Or depuis ce temps nous allâmes un peu plus retenus que de coutume, mais au sortir de ce
travail je rentrai en une autre qui n’était guère moindre, car nous ne pûmes si bien dissimuler,
qu’Alcippe, qui y prenait garde, ne reconnût que l’affection de son fils envers moi n’était pas
du tout éteinte, et pour s’en assurer, il veilla si bien ses actions, que remarquant avec
quelle curiosité il allait tous les jours à ce vieil saule, où nous mettions nos lettres, un matin il
s’y en alla le premier, après avoir longuement cherché prenant garde à la foulure que nous
avions faite sur l’herbe pour y être allez si souvent, il se laissa conduire, et le trac le mena droit
au pied de l’arbre, où il trouva une lettre que j’y avois mise le soir











![[title-image]1348818828720[/title-image]](https://ufr-phillia.parisnanterre.fr/medias/photo/upn-picto-web-organigramme-phillia_1492076639606-png?ID_FICHE=33531)